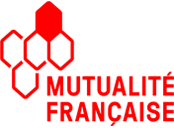Vers la républicanisation de la Mutualité
De l’atonie…
En dépit des bouleversements liés à la défaite contre l’Allemagne, à la chute de l’Empire et à la proclamation de la IIIe République, suivie de la période troublée de la Commune de Paris (1871), le mouvement mutualiste semble mener une existence paisible. Bien que de plus en plus structurée et efficace dans la prise en charge de la maladie, la mutualité ne semble pas faire les frais des soubresauts qui secouent la société française, contrairement au mouvement ouvrier, littéralement décapité à la suite de la Commune. Cet épisode, auquel s’ajoute l’apparition des premières organisations syndicales, bientôt légalisées par la loi Waldeck-Rousseau (1884), contribuent à accentuer le divorce entre les deux versants du mouvement social français. A cette relative indifférence face aux évolutions socio-politiques, répond une méfiance des pouvoirs publics à l’égard du mouvement mutualiste, qui a bénéficié des faveurs de l’Empire, et chez qui l’on redoute des sentiments anti-républicains : à l’exception de la loi du 27 octobre 1870 qui rétablit les élections des présidents, supprimées par Napoléon III, le pouvoir républicain fait en effet preuve de peu d’intérêt pour les sociétés de secours mutuels.
… Au réveil
Les choses changent à partir de la décennie 1880, marquée par un renforcement de la République qui s’appuie sur une politique réformatrice de grande ampleur – loi Ferry sur la scolarité en 1881-1882, loi sur la liberté de réunion et d’association (1881), liberté de la presse, légalisation des syndicats professionnels (1884), etc. Quelques personnalités politiques prennent alors conscience de l’intérêt de la mutualité en tant qu’alliée potentiel pour résoudre la question sociale, à l’instar de Léon Say, de Jules Ferry, de Jules Simon, de Pierre Waldeck-Rousseau ou de Jules Siegfried ; pour autant, aucune réforme n’est envisagée pour dépoussiérer la vieille législation impériale qui maintient les sociétés de secours mutuels dans un étroit carcan administratif, et limite leurs possibilités de développement.
Dans ce contexte, les mutualistes s’efforcent de rassembler leurs forces et de se faire entendre auprès des pouvoirs publics. En 1883, l’organisation du premier congrès national de la mutualité à Lyon, à l’initiative conjointe d’un militant mutualiste local, Auguste-Pierre Bléton, et d’un intellectuel républicain, député et sénateur de Versailles, Hippolyte Maze, marque la première étape de ce processus. Si les résultats de leur projet peuvent paraître modestes, avec la présence d’un dixième des forces mutualistes seulement, le rassemblement de Lyon lance cependant le coup d’envoi d’une tradition triennale, depuis lors ininterrompue. Le congrès est l’occasion pour Maze de définir un programme d’action pour la mutualité, considérée comme la solution idéale pour résoudre la question sociale. Il participe également de la construction d’une identité propre au mouvement, et pose le premier jalon de sa progressive républicanisation.
© FNMF
S’ensuit la création, toujours sous la houlette de Maze, de la Revue des institutions de prévoyance, en 1887, puis de la Revue de la prévoyance et de la Mutualité, en 1890, ainsi que de la Ligue nationale de prévoyance et de la mutualité, bientôt concurrencée par l’Union nationale des présidents de sociétés de secours mutuels. Avec des moyens limités, qui en font plus des sociétés d’étude et de réflexion que de réels groupements représentatifs, ces initiatives participent néanmoins à l’affirmation de la mutualité en tant que véritable mouvement social.
Une reconnaissance tardive
Au tournant du siècle, la réflexion sur la question sociale, la prévoyance et la place de la mutualité commence à évoluer, tant en interne dans les rangs du mouvement qu’au sein de la classe politique, où les voix sont de plus en plus nombreuses à préconiser une collaboration avec la mutualité. Ces débats sont relayés par le Musée social, fondé en 1894 dans le but d’étudier les problèmes économiques et sociaux de l’époque.
© coll. Cedias Musée social
Si un consensus semble envisageable entre les pouvoirs publics et les mutualistes, des divergences les opposent longtemps, notamment en ce qui concerne l’alignement sur le fonctionnement des compagnies d’assurance des groupements mutualistes, que ces derniers rejettent en bloc. Finalement, au terme de longs débats, la loi communément appelée « Charte de la mutualité », est adoptée le 1er avril 1898. Substituant à l’ancienne législation impériale un dispositif beaucoup plus libéral, elle consacre la reconnaissance durable de l’identité du mutualisme français et sa place de premier plan de protection contre la maladie.
© FNMF
Parallèlement à la reconnaissance de plusieurs types de sociétés – approuvées, reconnues comme établissements publics et libres –, le contrôle administratif est considérablement atténué, et l’intervention mutualiste ouverte à tous les domaines de la protection sociale, mais aussi aux cours et placement professionnels ainsi qu’aux allocations chômage. Par ailleurs, la limitation des effectifs est supprimée, et les groupements mutualistes autorisés à se rassembler en unions permettant de créer des services supérieurs, tels que des œuvres sociales, des caisses autonomes ou des services de prévoyance plus complexes. Cette puissance financière donne également les moyens à la mutualité d’améliorer ses prestations, notamment à destination des familles et des femmes. Pour finir, est permise la structuration au plan national qui aboutira, le 10 novembre 1902, à la création au Musée social de la Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF).
© FNMF
Sous la présidence du charismatique Léopold Mabilleau, doué d’un sens aigu de la communication, la jeune Fédération se lance dans une mission de popularisation de la mutualité au travers de grandes fêtes. Ponctués de défilés aux couleurs des bannières mutualistes, de discours, de concours de chant et de musique, et clôturés par de fastueux banquets rassemblant l’ensemble des participants ; ces rassemblements se tiennent en présence des plus hautes autorités de l’Etat. Ils symbolisent la reconnaissance du rôle social de la mutualité et ses liens étroits avec le gouvernement républicain, qui la considère désormais comme le cadre idéal pour expérimenter une troisième voie entre individualisme libéral et assurance obligatoire. Les fêtes sont aussi un moyen de faire voir la mutualité dans le paysage social, et de cristalliser une identité au travers de rituels et de cérémonies communs.
Table d’honneur des banquets des Mutualistes, © FNMF
La loi de 1898 ouvre une ère de prospérité parfois qualifiée, avec excès, d’« âge d’or » de la mutualité. Malgré la persistance d’un ancrage urbain et la difficulté du mouvement à pénétrer dans les campagnes – à la veille de la guerre, le taux de mutualisation de la société française plafonne à 15 % - les effectifs augmentent de façon continue, passant de 1,6 millions en 1895 à 3 millions en 1902, puis à 4,5 millions en 1914. Ces chiffres officiels doivent certes être pondérer en raison des fréquentes doubles adhésions, qui les ramènent à 3 à 3,5 millions environ, mais ils s’avèrent largement supérieurs aux syndicats (400 000 adhérents à la CGT à la veille de la Grande Guerre) ou aux partis politiques : à la même date, le parti socialiste SFIO rassemble 120 000 personnes. A cette croissance numérique, s’ajoute le développement des capacités gestionnaires des unions départementales, grâce auxquelles le mouvement peut se doter d’œuvres sociales de plus en plus nombreuses et innovantes. A l’image de la première clinique chirurgicale inaugurée à Montpellier en 1910, ces établissements sont révélateurs du dynamisme de la mutualité : cette dernière affirme sa volonté de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la maladie et la médicalisation de la société, à une époque où les menaces de dénatalité et de vieillissement hantent l’ensemble des élites. Alliés à l’appui du parti républicain au pouvoir, ces nouvelles dynamiques propulsent le mouvement mutualiste à une place inédite dans le paysage social français.